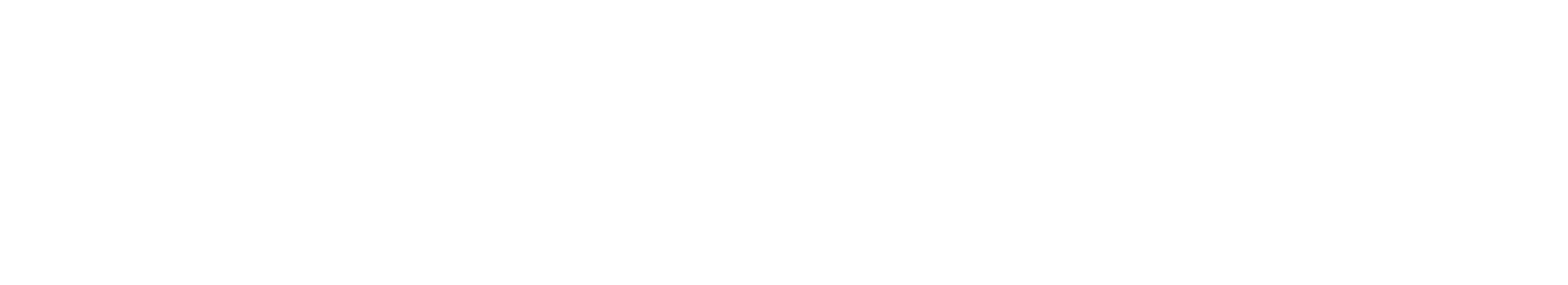Cher(e) ami(e),
À votre avis, ceci est-il un nouvel hôtel tendance ?

Si c’est ce que vous pensez, eh bien, vous faites fausse route !
Il s’agit du plus grand centre orthopédique d’Allemagne !
Un hôpital public donc !
Qu’il soit situé en pleine nature, cela saute aux yeux…
Mais ce qui s’y passe réellement est bien plus mystérieux.
Car là-bas, on applique une certaine thérapie qui commence à faire ses preuves…
… mais qui, comme souvent, est largement ignorée en France.
Avant de vous en parler, j’aimerais vous poser une question :
Votre dernière visite à l’hôpital, c’était comment ?
Personnellement, je suis originaire de Caen en Normandie.
Et voici l’hôpital où je rechigne absolument à mettre les pieds (mais il le faut parfois) :

Le CHU de Caen est typiquement un « hôpital-paquebot » – le seul de France.
Une tour d’hospitalisation, dans laquelle toute la ventilation est mécanique (les fenêtres ne s’ouvrent pas !).
Et tous les déplacements se font par la vingtaine d’ascenseurs, générant attente et stress.
Résultat : les patients s’y perdent facilement, tandis que le personnel passe des heures dans les ‘’transports’’ parmi les 23 étages.
Créé en 1975, le CHU de Caen avait pour objectifs ‘’d’être économe, fonctionnel et rationnel’’.
Bref, devenir une « usine à soigner et à guérir »… inhumaine.
Où personne ou presque n’a envie d’être hospitalisé ou de visiter un proche !
C’est tout de même un peu paradoxal qu’un hôpital devienne à ce point si inhospitalier !
Pourtant, le CHU de Caen ne fait pas exception.
Car en France, on a encore peu d’égards pour cette nouvelle thérapie…
C’est dommage quand on sait qu’elle est extrêmement salutaire pour les malades bien sûr, mais aussi pour le personnel ou les visiteurs.
La preuve :
Avez-vous déjà entendu parler d’ « architecture de la guérison » (healing architecture) ?
Ce mouvement naît dans les années 80.
Certains architectes et médecins commencent à interroger les liens entre les environnements intérieurs des hôpitaux, la santé des malades et la productivité.
Se développe alors une recherche architecturale basée sur des preuves (à l’image de l’Evidence based medecine).
Dès 1984, le Dr Roger S. Ulrich démontre que les patients opérés de la vésicule biliaire récupèrent plus rapidement s’ils ont une chambre avec vue sur un parc vert, par rapport à ceux avec une chambre avec vue sur… un mur en briques.
Les patients récupéraient mieux et plus vite, et ils étaient aussi moins stressés et nécessitaient moins de médicaments contre la douleur1 !
En 1993, le médecin américain, Horsburgh C. Robert, enfonce le clou :
- les perceptions sensorielles des patients hospitalisés impactent leur niveau de stress ;
- s’il est élevé, leur système immunitaire est affaibli ;
- ce qui augmente le risque d’infections et un retard dans la cicatrisation.
Parmi les facteurs de stress, il identifie : les bruits excessifs, les interruptions de sommeil, le manque de lumière du jour ou encore un environnement coupé de la nature2…
Si vous avez été hospitalisé un jour, je suis certaine que ces expériences vous parlent…
Ainsi, comme le résume parfaitement l’architecte Stefan Lundin :
« L’architecture est une mesure non médicale
qui peut contribuer à des résultats médicaux. »
Mais alors, concrètement, ça ressemble à quoi un hôpital tourné vers la guérison ?
Repartons à la clinique Eisenberg3, en Allemagne, où les patients sont traités comme de véritables « hôtes » (du latin hospes).
Voici ce que vous y trouvez :
- Un restaurant lumineux où l’on sert une cuisine fraîche, de saison, saine (pas de purée lyophilisée).
- Des chambres doubles conçues en “Z”, pour préserver l’intimité des patients tout en gardant une circulation fluide.
- Des vérandas reliant les espaces, baignant dans la lumière naturelle.
- Des matériaux bruts, chaleureux : bois, teintes douces, inox hygiénique, signalétique claire.
- Et surtout, des mesures concrètes contre les infections nosocomiales, le risque n°1 à l’hôpital : des lavabos sans trop-plein, rampes et poignées en acier inoxydable, moins de joints = moins de saletés et de germes…

Franchement… est-ce que ça ressemble à ce que vous avez connu lors de votre dernière hospitalisation ?
D’autant que ce centre public allemand n’est pas le seul dans le monde à expérimenter les bienfaits de cette architecture thérapeutique !
Ici, le Maggie’s Leed center, dans le Yorkshire (Grande-Bretagne), où ce centre de cancérologie laisse une grande place au bois :

Ou encore ici au Canada, l’hôpital St Mary’s de Sechelt en Colombie-Britannique, où 75 % des espaces reçoivent de la lumière naturelle4 :

Ou encore l’hôpital d’Agatharied en Allemagne, construit comme une petite ville, avec 7 pavillons5 :

Ou enfin, aux Pays Bas, où l’hôpital pour enfants Emma, a été pensé comme « foyer », plutôt qu’un lieu exclusivement médical6 :

Et si ces hôpitaux n’étaient pas juste bien pensés… mais profondément guérisseurs ?
Et si, au fond, ce n’était pas qu’une affaire de murs, de lumière ou de silence…
… mais une philosophie de soin ?
Une façon de penser la santé autrement ?
Ces hôpitaux activent votre salutogenèse… imaginez la vôtre !
La salutogenèse, c’est la grande découverte du sociologue américain, rescapé des camps, Aaron Antonovsky.
Il a posé la question qui fâche :
Pourquoi certaines personnes restent en bonne santé malgré des circonstances difficiles ?
Et à l’inverse, pourquoi certaines personnes tombent malades malgré des circonstances favorables ?
Sa réponse : ce n’est pas tant la maladie qui rend ‘’malade’’… mais bien l’absence de cohérence, de confiance, de sens et de soutien.
Et à l’inverse, plus vous sentez que votre environnement vous porte, que vous n’êtes pas seul,
plus vous retrouvez confiance en vos ressources,
plus vous activez, sans vous en rendre compte, votre pouvoir de guérison.
Encore aujourd’hui, c’est cette théorie de la salutogenèse qui guide l’architecture thérapeutique.
Ces hôpitaux cherchent à créer des environnements porteurs, qui restaurent le sentiment de sécurité, de maîtrise et de dignité.
Une vision holistique et humaniste de la santé, à laquelle je souscris évidemment.
Alors, quand je vois qu’en France, on en est encore à débattre sur les moyens de faire des économies, de « personnel en burn-out », de « fermeture de lits » ou de « saturation »…
… je suis atterrée. Et triste aussi…
Car personne ne questionne notre système ‘’de santé’’ centré sur la maladie…
… et encore moins les conditions qui créent l’explosion de toutes nos maladies… qui nous poussent à surcharger les hôpitaux !
Le changement de paradigme est plus qu’urgent…
Vous l’avez compris, n’attendez plus pour enclencher tout ce qui peut favoriser votre salutogenèse.
Bonne santé !
Catherine Lesage
PS : La salutogenèse chez vous, c’est possible aussi ! Si le sujet vous intéresse, dites-le moi et je vous donnerai quelques conseils pour l’appliquer chez vous !
PS 2 : Conseil d’ami : en cas d’hospitalisation, demandez donc toujours si cela est possible une chambre avec vue !